









LE BON VIEUX TEMPS …
Pas de corvée de vaisselle, certains, après le repas, rangeaient les assiettes, les couverts et les verres dans les tiroirs. Les plus courageux faisaient la vaisselle sur la table, dans une cuvette. Il n’y avait pas d’eau à l’évier, il fallait aller la chercher dehors dans le bassin qui se trouvait devant la maison.
On lavait le linge à la main, à l’eau froide, avec du savon de Marseille, l’hiver dehors dans le bassin et l’été dans la boutasse *(mare à proximité des fermes).
C’était mieux avant !
Pas de facture d’électricité à payer, on s’éclairait à la bougie et à la lampe à pétrole. Donc pas de lave-linge, du reste qui aurait pu s’en payer un ? Pas de télévision évidemment, le soir, on restait autour du feu, on chantait en patois, en français, accompagné à l’harmonica par mon père. On jouait aux cartes, aux 500, à la belote, à la bataille. L’électricité est arrivée à La Versanne en 1952.
C’était bien mieux avant !
Pas de matelas à retourner régulièrement, il n’y en avait pas, on dormait sur des paillasses, sortes de grands sacs plats remplis de feuilles. A l’automne, on allait chercher des feuilles pour refaire les paillasses, un bout de bois s’invitait parfois avec les feuilles, et aussi des souris.
Les hivers étaient longs et rigoureux, du givre recouvrait toutes les fenêtres de la maison. Les chambres n’étaient pas chauffées, la température pouvait y descendre jusqu’à moins 6°. Il fallait porter des bonnets de nuit pour avoir chaud. On dormait en bas dans des lits placards.
C’était nettement mieux avant !
Pas de cuisine laboratoire, pas de cuisine intégrée, pas de micro-onde. Dans les fermes, on entrait directement dans une grande pièce où trônait un fourneau et une grande table bordée de bancs. Cette pièce faisait office de cuisine, de salle à manger, (on ne connaissait pas le mot « salle de séjour ») et aussi de chambre avec ses lits placards. On allumait le fourneau tous les jours, même en été, pour chasser l’humidité. On l’allumait avec des babets *(pommes de pin), des ruches *(grandes écorces de pin) et du bois, de préférence du fayard *(hêtre). Avec ce fourneau, on pouvait avoir un peu d’eau chaude grâce à la bouillote située sur le côté du fourneau.
On ne se plaignait jamais, c’était le bon vieux temps … En êtes vous vraiment sûrs ?
Denise et Jean Copin.
Rédigé par Marie-France Pan
*boutasse : mot utilisé dans le parler gaga, patois de la région stéphanoise.
*babet : parler « gaga ».
*ruche : ce mot est utilisé aussi en Ardèche avec le même sens. C’est un mot très ancien, d’origine gauloise « rusca » qui signifiait écorce.
*fayard : mot d’origine franco-provençale.
Il est un temps que les moins de quarante ans auront du mal à reconnaître, c’est celui des années 60/70.
Il fut ce temps où nous habitions un pays, la Versanne, où nous avions quatre saisons.
De la pluie, des « pesets » de neige au printemps, des étés courts mais chauds, l’automne presque indien et l’hiver neigeux, froid et parfois glacial vers février et qui pouvait par caprice s’étirer jusqu’à la fin avril.
L’hiver, c’est la remarque de Pépé Louis qui au mois de février disait « l’hiver c’est la moitié de la récolte de foin ». Ceci renseigne sur les dates d’entrée de l’hiver vers la toussaint pour finir fin avril de l’année suivante. Considérons que ces repères ont évolué avec les changements climatiques.
Les souvenirs de l’enfance, c’est un vrai hiver avec de la neige, voire un paquet de neige…
Il me souvient des retours en voiture avec la 203, très mauvaise voiture sur la neige, mon père obligé d’empiler des sacs de gore dans le coffre pour assurer une relative adhérence et malgré cela, l’histoire se finissait immanquablement de la même manière : à partir de Brenade, la voiture patinait puis à l’amorce de la montée de Fogères elle s’arrêtait bloquée par une congère. Mes frères et moi, restions dans la voiture et regardions notre père, chaussé de bottes, s’éloigner pour prévenir pépé.
Louis, habitué à ce scénario, liait deux vaches, les rouges comme il les appelait. La petite famille voyait rappliquer Pépé Louis avec « la carlin » et « la gitane » sous la sibère avec la neige qui tombait à l’horizontale. Et hop, un coup de chaîne et l’attelage démarrait pour rejoindre sa destination d’un pas tranquille.
Je me rappelle alors que nous avions entre 6 et 10 ans, d’avoir eu le souffle court après avoir ouvert le portail protégé de la Burle. La bise tellement puissante nous obligeait à marcher à reculons jusqu’au châtaignier du meunier surnommé Le cardinal. Après Brenade, que du bonheur, on se remettait en marche avant pour atteindre l’arrêt du car. Là, il nous arrivait de poireauter plus d’une demi-heure devant le bar de chez Equis. L’hiver, la ponctualité n’était pas l’apanage du car de ramassage scolaire.
Malgré tout, nous étions contents, heureux lorsque le vent cessait de souffler de faire de la luge sur nos cartables et d’arriver à l’école « trempés comme des soupes », expression locale en vigueur.
Il me souvient d’avoir pratiqué la luge avant de prendre le chemin de l’école. Une biscotte, un café au lait et aussitôt sur la luge de sept heures quinze à sept heures quarante-cinq. Le jour n’était pas né. La réverbération de la lune sur la neige nous facilitait la tâche. Il était tombé beaucoup de neige, le gel avait pris le relais et nous avait concocté une piste de neige dure, comme damée. Le vent avait soufflé formant d’énormes congères qui estompaient murs, chemins, tous les creux et les bosses des paysages.
Un vrai régal, une piste de pro pour nous seuls ! Tellement bien que l’inévitable advint, un jour je me suis ramassé une gamelle sévère qui m’a conduit direct chez le rebouteux.
Pas d’école ce jour-là… une entorse !
Il me souvient d’apprentissage du ski en autodidacte dans le pré Tardy, derrière le presbytère, avec mon copain Dominique, « la classe ».
Nous étions fourbus, éreintés, cassés après nos séances de ski de piste. Imaginez, vêtus de pulls et pantalons, avec au pied des skis, pas de tire-fesse, des remontées en canard après chaque descente. Combien de calories dépensées dans cet exercice physique qui nous procurait pourtant beaucoup de plaisir.
Il me souvient aux Rouaires avec tatan Maria, d’avoir roulé des boules de neige de plus en plus grosses pour en faire des igloos où on buvait un café pour de faux avec mon frère René.
Toujours aux Rouaires, image de pépé Jean, chaussant ses brodequins cloutés pour m’emmener faire un viron sur des rochers recouverts de neige à la recherche de ses pièges à renard.
Autant sa démarche à la maison reflétait son âge, autant on assistait à une transfiguration lorsqu’il enfilait ses brodequins pour aller à la chasse ou braconner. Ça dépendait des jours.
Nous aimions les Rouaires car il y avait une différence de quantité de neige, plus importante aux Rouaires qu’à Fougères. Jamais nous n’avons prononcé « Fogères ».
L’hiver aux Rouaires, c’était la certitude de manger des grives que le pépé dégommait par dizaine avec son fusil de chasse. Préparées par la Gustine, ma grand-mère, J’en ai encore les papilles toutes émoustillées tant son jus était divin.
L’hiver aux Rouaires, c’était la brique-chaude enveloppée de papier journal que nous préparait tatan Maria ou ma grand-mère.
Il n’y avait pas de chauffage dans les chambres du haut, un seul et unique poële à charbon en bas dans la grande pièce. J’ai le souvenir qu’on ne perdait pas trop de temps avant de s’endormir avec notre brique-bouillotte.
Au matin, on soufflait doucement pour dessiner des petits ronds sur les carreaux gelés.
Il y aurait tant à conter sur ces souvenirs de môme, de neige, du cochon qu’on saigne et qu’on baconne avec les voisins à tour de rôle, de la trace faite à la main, des corvées pour fendre le bois de mémé Joséphine. J’en passe et j’en oublie.
D’autres témoignages viendront enrichir ce feuilleton « Hiver à la Versanne ».
Jean-Yves Barralon
Le froid
Le froid et son convoi
De neige et de verglas,
Sème le désarroi
Sur les toits et les voies.
Les villageois sont aux abois
Et se demandent « qui fera quoi » ?
C’est la loi du « débrouille-toi »,
Ici un feu de joie,
Là des gueules de bois .
Je m’emplis de noix
Pour faire le poids
Et ne pas rester sans voix.
Le froid, ma foi, ce n’est pas pour moi,
Mais peut-être pour toi.
Marie-France Pan
« Les hivers étaient plus rudes qu’aujourd’hui : vers la fin des années 60, j’étais à l’école à La Versanne. Plusieurs fois, mon père m’a accompagnée à l’école à pied. Il attachait ses bottes pour éviter que la neige rentre dedans. Il partait devant moi pour faire « la trace ». Les congères étaient énormes par « La Litte ». Avec le vent qui soufflait, j’arrivais trempée à l’école. Heureusement que nos pantoufles nous attendaient. Les sœurs mettaient du papier journal dans nos bottes pour éponger la neige qui était rentrée dedans. »
« Gros amas de neige «bleue » 1982 où l’électricité avait fait défaut 3 jours (très pratique pour la traite des vaches). Personne n’était équipé de groupes électrogènes ».
Geneviève
Si vous avez des témoignages, des documents, des photos, des vidéos qui peuvent enrichir nos thèmes.

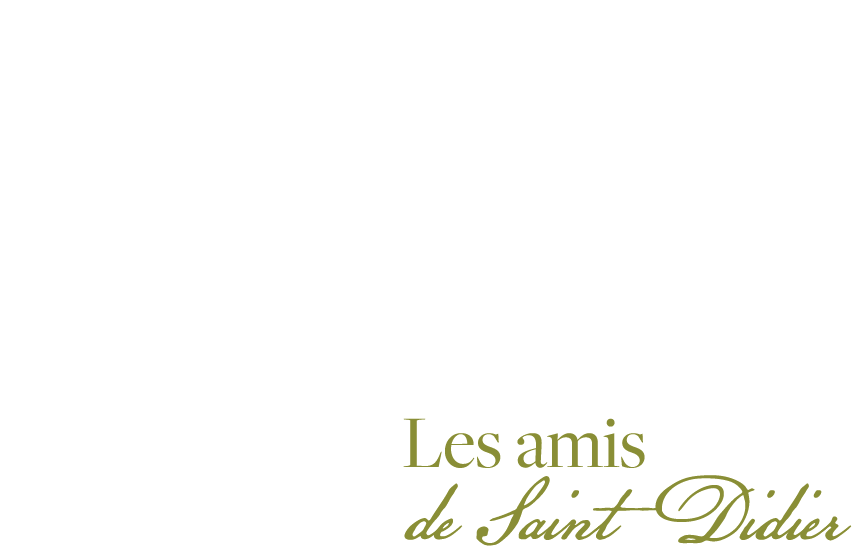
Les Amis de St Didier© 2025. Tous droits réservés / Réalisation by Alphaci